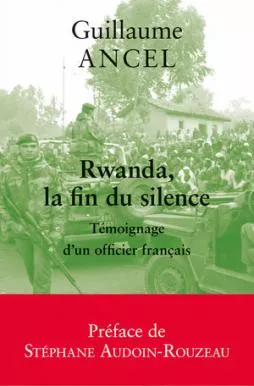
Il faut lire Rwanda, la fin du silence, témoignage d’un officier français. L’officier en question c’est Guillaume Ancel qui, à l’été 1994, a participé comme capitaine à l’opération Turquoise lancée le 22 juin par la France dans ce pays d’Afrique où se déroulait un génocide contre les Tutsi (800 000 morts en trois mois) orchestré par le gouvernement en place à dominante hutue.
Le livre, préfacé par l’historien Stéphane Audouin-Rouzeau, est publié aux Belles Lettres, dans la collection Mémoires de guerre où Ancel est en bonne compagnie (Buzzati, Churchill, Galula, Kipling, etc.) et c’est la première raison de le lire : il est passionnant. Ancel nous fait plonger sur le terrain, au cœur des opérations, dans un pays dévasté en proie au chaos. Son récit permet de saisir l’essence d’une opération extérieure, c’est-à-dire de la guerre. On comprend l’importance de l’information tactique, de la coordination et de la logistique. On suit ce tempo très particulier où l’attente est la « principale occupation ». Peu d’actions sont spectaculaires mais la tension et les rapports de force sont omniprésents ; la violence vient par à-coups. On se familiarise avec les codes de cette institution à part que reste l’armée, où les rivalités ne cessent jamais vraiment mais qui, dans un environnement extrême, sanctifie la camaraderie, la maîtrise de sa propre violence, la discipline et le respect des ordres. Ces témoignages sont une pierre essentielle pour la compréhension des guerres[1] que l’imbrication des trames politique et militaire rend toujours complexe. Le terrain amplifie ce qui se décide « en haut », il est un livre ouvert sur la qualité, ou la non-qualité, de la stratégie des décideurs et leurs ambiguïtés.
Et puis il y a les faits. Ancel ne livre pas une interprétation, il en fait le récit, précis, étayé par les notes de son carnet d’opérations et sa mémoire. Les faits ne sont pas polémiques, ils sont ce qu’ils sont. Ils sont surtout vérifiables. Tout débat doit partir de là. Et que dit-il ?
Sa mission c’est le Forward Air Control, le guidage au sol des frappes aériennes, expertise dont la présence dans une mission annoncée comme humanitaire peut surprendre. Ancel raconte comment il reçoit « un exemplaire numéroté d’un ordre préparatoire » pour une mission de bombardement, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, du FPR montant sur Kigali. En clair, créer les conditions pour un raid terrestre de la Légion et d’autres entités aguerries sur la capitale. « En théorie c’est assez simple, je dois dégager un couloir en guidant les frappes des avions de chasse ». La mission est stoppée in extremis, à l’aube du 1er juillet, alors que ses équipes sont embarquées dans les Super Puma prêts à décoller pour le théâtre d’opérations. Ce récit contredit la version officielle d’une opération purement humanitaire. Il montre que, dans un premier temps, Turquoise comprenait une opération de combat de haute intensité qui visait à sauver le régime en place. Stéphane Audoin-Rouzeau parle d’une « intervention militaire supposant une sorte de co-belligérance avec le gouvernement intérimaire et ses forces armées, et donc avec les responsables du génocide, à cette date presque accompli ».
Deuxième quinzaine de juillet. Paris a compris que la victoire du FPR est acquise. Ancel est dans la Zone Humanitaire Sûre créée par les forces de Turquoise. Il reçoit l’ordre de détourner l’attention des journalistes présents pendant que passent une dizaine de camions porteurs de conteneurs maritimes. Réponse à ses questions lors du briefing: « ces armes sont livrées aux FAR (Forces Armées Rwandaises, l’armée gouvernementale) au Zaïre, cela fait partie des gestes d’apaisement que nous avons acceptés pour caler leur frustration et éviter qu’ils ne se retournent contre nous ». Pour être clair, la France livre, en contravention avec l’embargo de l’ONU en vigueur depuis le 17 mai 1994, des armes aux responsables du génocide. Accessoirement si l’on peut dire, on apprend que l’on paye leurs soldes en liquide « pour éviter qu’ils ne deviennent incontrôlables ». La Zone Humanitaire Sûre permet la fuite des génocidaires au Zaïre où, armés, ils poursuivront une politique meurtrière et déstabilisatrice; les militaires présents le comprennent parfaitement, ils n’ont pas reçu l’ordre de se saisir des responsables qui traversent la zone.
Le récit se poursuit avec la recherche de rescapés et diverses missions de sécurisation dans un contexte où les miliciens sont omniprésents et encore confiants, tel ce bourgmestre autorisé par les forces spéciales françaises à conserver ses armes alors qu’il a méthodiquement organisé le massacre des Tutsi du village. Lors d’une rencontre fortuite avec des miliciens Ancel reconnait sur l’un deux le gilet d’un camarade belge abattu à Kigali dans les premiers jours du génocide. Il demande aux légionnaires qui l’accompagnent de récupérer le gilet. L’ordre ne discute pas les moyens, en tout cas Ancel n’en parle pas : ils sont violents. Les légionnaires engagent un bref combat, les douze miliciens sont tués.
Dans la dernière partie Guillaume Ancel raconte après l’intervention. Vingt années pendant lesquelles les questions se transforment en doutes puis en volonté farouche de faire émerger la vérité. Les Belges font, très vite, une introspection approfondie sur la nature de leur engagement. On en est très loin côté français où une histoire officielle domine et bonne chance à ceux qui la mettent en cause ! Les politiques agitent l’honneur de la France et de l’armée pour bloquer tout examen sérieux de leurs décisions, l’armée est muette par tradition et entend bien le rester, en dehors que quelques journalistes et associations la population n’est pas intéressée. Jusqu’où es-tu prêt à aller ? lui demande le journaliste Patrick de Saint Exupéry ; la phrase prendra tout son sens quand des menaces directes se feront jour.
Guillaume Ancel a livré sa part de vérité. Les faits rapportés sont pour la plupart connus des spécialistes mais, faute de volonté du Pouvoir de faire le clair, ils sont pris comme l’ensemble des éléments du dossier dans la polémique qui, depuis 24 ans, entoure le rôle de la France au Rwanda. Un quart de siècle plus tard les citoyens français ont le droit de savoir quelle était vraiment la politique conduite en leur nom et les leçons qu’il faut en tirer. Ils sont en droit d’exiger l’examen critique des faits dans leur ensemble, c’est pourquoi l’ouverture complète des archives est nécessaire et fait l’objet de demandes répétées[2]. La polémique doit laisser la place à un travail scientifique, condition sine qua non pour une compréhension apaisée des événements. Il n’y a pas de vérité avec un grand « V » en histoire, il y a des interprétations dont aucune n’est définitive mais qui toutes doivent tendre à l’objectivité. « L’interprétation de l’histoire n’est valable que par rapport aux intentions —des objectifs servis par des moyens— des acteurs » enseignait Raymond Aron. L’histoire de la politique française au Rwanda sera complète quand, au récit du capitaine Ancel, et d’autres avant lui, s’ajoutera la compréhension, non-polémique, des intentions des plus hauts dirigeants de l’Etat. Ce sera alors au pouvoir politique d’en tirer les conséquences et de décider du travail de mémoire et de réparation.
Le livre de Guillaume Ancel apporte une pierre essentielle à l’effort de vérité ; puisse-t-il aider à comprendre que la fin du silence, avant d’être une menace pour quelques-uns, est une opportunité pour tous.
[1] Dans ce registre on peut relire les Manuscrits de guerre de Julien Gracq (Joseph Corti, 2011), mieux qu’aucune étude académique ils permettent de comprendre comment une forme ancienne de la guerre dominait dans l’armée française de 1940 et comment cette guerre moderne fut perdue dans les têtes avant même le début des combats.
[2] http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/03/monsieur-le-president-faites-enfin-ouvrir-les-archives-sur-le-rwanda_5168336_3212.html?xtmc=rwanda&xtcr=182

Commentaires
merci Philippe, pour cette
Merci Philippe pour cette contribution
La France est bien un pays pratiquant à haute dose le mensonge d'Etat, quand les personnes investies d'un pouvoir d'Etat et d'une mission régalienne seraient éventuellement condamnables devant une juridiction française.
J'ai observé un grand nombre de mensonges d'Etat, bien organisés aussi bien par Mitterrand que Védrine, par Chirac ou Villepin, par Sarkozy ou Hollande. Il y a eu quelques exceptions étonnantes (Fabius dans l'affaire du Rainbow Warrior, Chirac dans la reconnaissance de la responsabilité de la police française dans la rafle du Vel d'hiv). Mais ces exceptions ne sont elles pas tout simplement dues à une analyse d'un risque plus grand à maintenir le mensonge d'Etat qu'à avouer la vérité ?
Quid de l'affaire Sarkozy/Khadafi qui, si elle est avérée, va porter un coup terrible à la France et pas seulement à Sarkozy... Macron va t il décider de stopper l'affaire par un "non-lieu" dont l'Etat français a in fine le pouvoir ? Wait & see. Mais sur le Rwanda, Philippe, good luck...et par avance, bonne consolation !
Message du colonel Hogard, auteur de "Les larmes de l'Honneur"
Ayant appris la recension faite par Philippe Bois du livre de Guillaume Ancel, le colonel Jacques Hogard, qui fut commandant d'un des trois groupements opérationnels de l'opération Turquoise (et "dirige aujour'hui un groupe de sociétés de conseil à l'international"), a tenu à nous adresser son propre témoignage : son livre, "Les larmes de l'Honneur. 60 jours dans la tourmente du Rwanda", édité en 2005 puis réédité en 2016, ainsi que "la recension [qu'il a] faite du livre de Guillaume Ancel pour le magazine 'l'incorrect', seul et unique média avec France Info à avoir sollicité une réaction de [sa] part ! ". Il nous dit dans son courrier penser qu'ainsi "la vigilance du Club des vigilants ne pourrait que s'en trouver enrichie et renforcée !".
Vous pourrez trouver ce texte en cliquant ICI
Génocide des Tutsi
Rwanda - Ancel - Hogard
Le jugement de Salomon
Rwanda - Ancel/Hogard
Commentaire HOGARD
Ce qui est sûr c'est le
Voici un livre qui m'a
Rwanda , la vérité est autre
Vivement l'ouverture des archives
Ajouter un commentaire