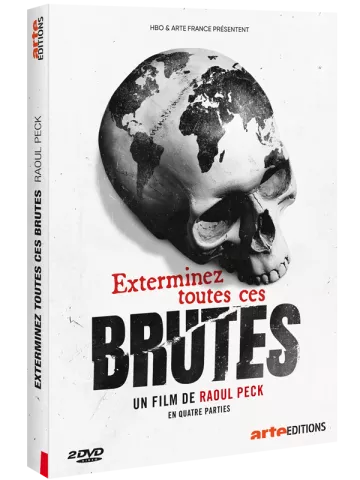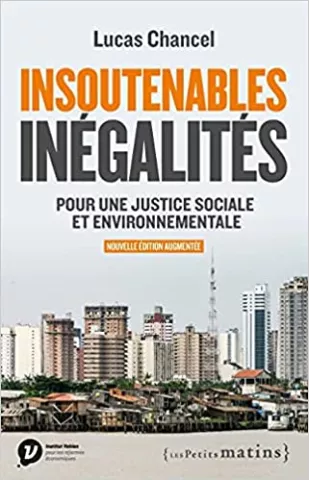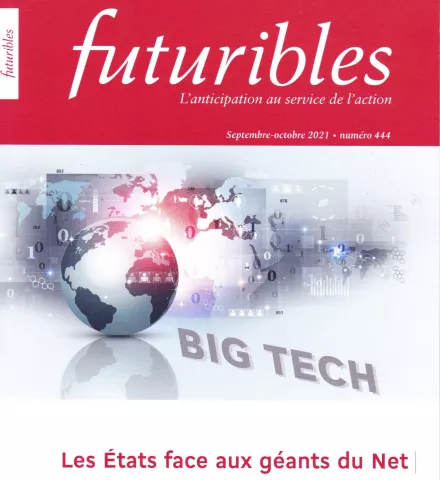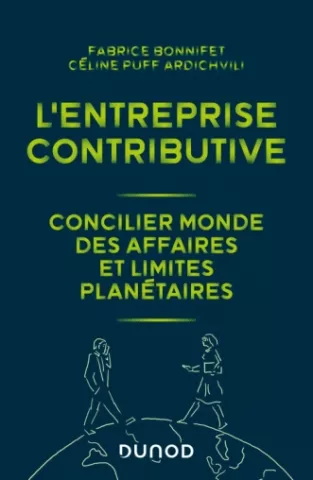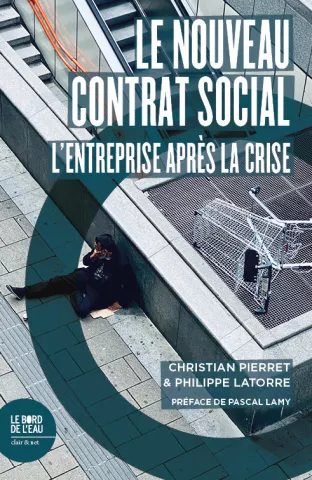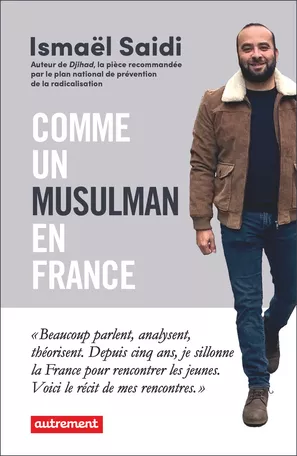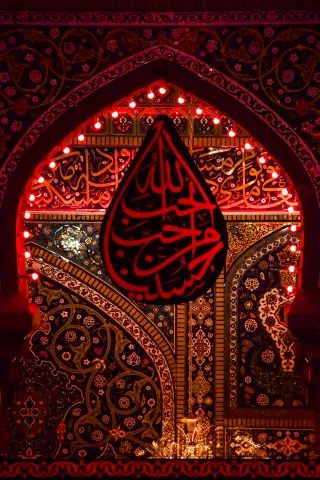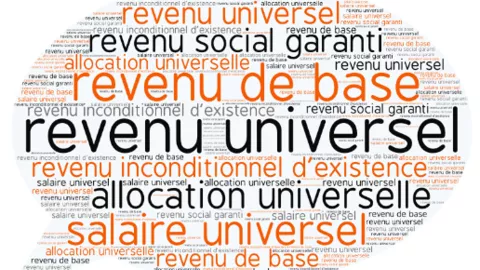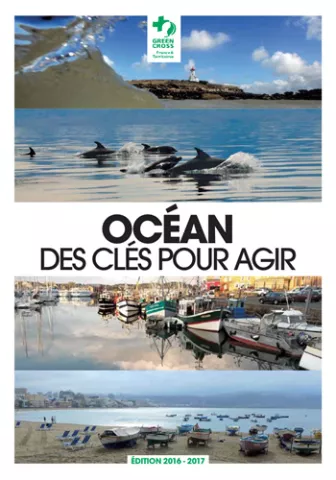Critique radicale contre le colonialisme occidental, cette série de quatre films diffusée sur Arte s’intitule « Exterminez toutes ces brutes », citation empruntée par un ami du réalisateur, Sven Lindqvist, à Kurtz, personnage mythique de « Au cœur des ténèbres » de Conrad.
Raul Peck, le réalisateur, est un haïtien de 68 ans qui a beaucoup vécu ailleurs, notamment à Berlin et à Paris (où il fut président de la Fémis de 2010 à 2019). Il a été ministre de la Culture de Haïti (1995-1997). Il réalise des films depuis longtemps. Arte avait déjà diffusé « I am not your negro » à partir d’un texte de James Baldwin. L’intérêt et la limite des films de Peck c’est qu’ils défendent un point de vue. Ce n’est pas dans le pamphlet cinématographique dont il est question ici que vous trouverez la moindre allusion aux routes ou chemins de fers tracés par le colonisateur ou aux méfaits des autres (esclavagisme dans les sociétés colonisées ; envahisseurs dont ont souffert nos lointains ancêtres, etc…). Certes il s’agit d’un véritable procès à charge contre l’Occident colonisateur et la forme-même exaspère souvent (pourquoi nous montrer les films amateurs de sa famille ? Qu’apportent les passages de fiction dont il émaille son propos ?). Néanmoins reste l’intérêt de ce qu’il nous assène, inspiré des livres de plusieurs de ses amis qu’il donne envie de lire (voir références plus loin) et qui peut contribuer pour certains des téléspectateurs à mieux comprendre combien « nous », les Occidentaux en général, sommes parfois victime d’un esprit néo-colonialiste culturellement bien ancré en nous.
Ceci vient en quelque sorte en écho (certes très grossissant) des propos interpellants tenus par deux des invités récents du Club des Vigilants sur la vision néocoloniale du Monde que notre éducation nous a laissé dans un coin de la tête.
En avril dernier l’historien Pascal Blanchard a ainsi expliqué combien cette histoire non purgée de la colonisation contribue à bloquer l’intégration dans la société française d’un grand nombre de descendants de colonisés aujourd’hui citoyens français Et a proposé, dans l’esprit des Vigilants, quelques mesures concrètes pour « purger » notre histoire coloniale.
En novembre le diplomate et historien Jean-Pierre Filiu, nous a dit en substance que notre vision quelque peu condescendante du Moyen-Orient nous empêchait d’y déceler les aspirations à la démocratie et la capacité qu’auraient ces pays à se gouverner démocratiquement si nous ne considérions pas leurs dictateurs comme un pis-aller.
Voici quelques-unes des idées forces de cette série.
- Les croisades, l’expulsion d’Espagne des juifs et des musulmans, les « grandes découvertes », la conquête de l’ouest américain, la colonisation de l’Amérique latine, puis de l’Afrique et de l’Asie par les nations européennes, tout cela procède du même et vaste mouvement de colonisation. C’est une même histoire.
- Les découvertes n’ont découvert aucun territoire vide. Partout il y avait des habitants et des civilisations, voire même des civilisations « supérieures » à celles des colonisateurs (Chine, Inde, etc…). Les découvertes/colonisations sont l’entreprise de pays plus ou moins misérables disposant de deux avantages concurrentiels : des bateaux et des armes tuant à distance (Portugal et Espagne notamment). C’est ainsi que dans le troisième épisode (sans doute le plus intéressant) il évoque le massacre à coup de fusils à répétition et de mitrailleuses de la bataille d’Omdurman au Soudan en 1898, chroniquée par le jeune Winston Churchill.
- Cette colonisation est impitoyable et s’accompagne de massacres, voire de génocides, et d’esclavage qui est une autre forme de génocide.
Et ainsi, alors que cette série, coproduite par HBO, est destinée aussi au public des États-Unis, Peck revient à plusieurs reprises sur le massacre systématique des Indiens au cours du XIXe siècle pour libérer les terres dont les colons avaient besoin. Plusieurs fois aussi il revient sur le Congo de Léopold II, caricature de colonialisme avide et destructeur qui a inspiré plusieurs grands livres (cf. Références en fin).
- Ces horreurs n’ont pas manqué de poser quelques questions dans les pays colonisateurs. Peck évoque la Controverse de Valladolid (les sauvages ont-ils une âme ?) et nous rappelle que les Lumières ont été contemporaines de l’esclavage. Selon lui, l’Occident s’est construit une armure intellectuelle et idéologique pour justifier ses exactions à ses propres yeux. C’est le rôle du darwinisme social et du racisme scientifique du XIXe siècle. Dès son apparition dans les dictionnaires le noir, « nègre », est connoté péjorativement. Le nazisme et la Shoah ne sont pour Peck que la continuation logique de ce processus.
De tout cela il reste plus que des traces dans nos têtes et les livres d’histoire de nos enfants (peut-on encore parler des « grandes découvertes » ?). Pour ne pas parler de la France on est stupéfait de redécouvrir que le nom de code de Ben Laden pisté pour élimination par les troupes spéciales américaines était… Géronimo.
Références des livres des amis de Peck
Exterminez toutes ces brutes ! Un voyage à la source des génocides », de Sven Lindqvist, Ed Les Arènes 2014.
Silencing the Past: Power and the Production of History, de Michel-Rolph Trouillot (1949-2012), anthropologue haïtien. 1995. Réédition chez Beacon Press.
A People's History of the United States, de Howard Zinn, livre de 1980 chez HarperCollins publié en français en 2003 chez Agone.
An Indigenous Peoples' History of the United States, de Roxanne Dunbar-Ortiz, livre de 2015 chez Beacon press publié en français en 2021 sous le titre Contre-histoire des Etats-Unis chez Wildproject.
Sur la colonisation du Congo
Le rêve du Celte (El sueño del Celta), de Mario Vargas Llosa, chez Gallimard.
Congo de Eric Vuillard , chez Actes Sud.
Et surtout, semble-t-il, Congo une histoire, de David Van Reybrouck, chez Actes Sud.
La crise sanitaire liée au COVID a-t-elle accentué les inégalités sociales à l’échelle mondiale, entre pays et au sein même de chaque société ? Ou, plus grave encore, a-t-elle mis au jour les failles des systèmes économiques, politiques, sociaux et environnementaux à l’heure de la mondialisation ?
C’est à cette dernière question, lourde de conséquences et d’enjeux, que cherche à répondre l’ouvrage de Lucas Chancel1 intitulé Insoutenables inégalités – Pour une justice sociale et environnementale.
L’auteur part du constat que la crise sanitaire du COVID a exacerbé les inégalités à travers le monde, autant en termes d’exposition (les « premiers de corvée ») que de moyens (accès aux soins plus difficile pour les populations précaires, d’autant plus dans les pays où la politique sociale est réduite). Et parallèlement, la richesse des milliardaires a augmenté de 3800 milliards d’euros entre fin 2019 et début 2021, alors même que la production mondiale a enregistré une baisse considérable. C’est sur la base de ce paradoxe que Lucas Chancel cherche à mettre en évidence les dysfonctionnements de plus en plus flagrants et insoutenables, autant socialement que du point de vue environnemental.
Pour l’auteur, différents facteurs peuvent expliquer ces inégalités. D’une part, la mondialisation depuis les années 1990 explique en partie la tendance à la hausse des inégalités, mais ne permet pas de comprendre les différences observées entre pays, qui dépendent des politiques développées par chacun. D’autre part, la libéralisation des marchés (mondialisation financière) a augmenté la taille des marchés et leurs rendements, mais les résultats ont été redistribués à une minorité (élite aux revenus mirobolants), ce qui a généré une concentration des revenus et du capital. Par ailleurs, l’affaiblissement de la justice sociale associée à celui des syndicats a contribué à l’augmentation des inégalités. Les mécanismes de pré-distribution (ex : salaire minimum) ont diminué là où les inégalités ont augmenté fortement. Ainsi, aux Etats-Unis, le salaire minimum est passé de 11,80 $ en 1968, à 7,25 $ aujourd’hui. De plus, les mécanismes de redistribution ont fortement chuté. D’une part les aides sociales ont baissé, d’autre part la fiscalité sur les hauts revenus a été massivement réduite. Elle est passée de 70% à 40% sur les 30 dernières années pour les pays de l’OCDE (en moyenne), de 80 à 40 % pour les Etats-Unis. Les inégalités ont augmenté le plus là où le taux d’imposition a baissé le plus (Etats-Unis, Grande Bretagne). En outre, la course à l’innovation technologique a induit une forte demande d’individus qualifiés qui ont bénéficié du gain de productivité, au détriment des autres salariés moins qualifiés. Enfin, les élites économiques représentant les intérêts du monde de l’entreprise parviennent à influencer de plus en plus les politiques publiques. Ces détenteurs du capital ont un pouvoir politique croissant et une incidence forte sur le reste de la société.
Luc Chancel met en évidence que ces inégalités économiques affectent toutes les dimensions du développement, remettant en question le caractère durable de la voie choisie : ces inégalités menacent non seulement les principes démocratiques, mais elles ont également un impact sur la santé, et contribuent à la dégradation de l’environnement vers une limite bientôt irréversible.
La justice sociale doit donc être réintégrée au sein de la réflexion sur le développement durable. En effet, d’une part les inégalités environnementales renforcent les inégalités socioéconomiques : la dégradation de la santé due à la pollution accentue par exemple la précarité. D’autre part, les individus les plus aisés ont une empreinte écologique plus élevée et par ailleurs ceux qui polluent le plus sont ceux qui subissent le moins de dégâts de la pollution qu’ils génèrent. Il y a donc une injustice en matière de responsabilité.
Mais pour replacer la justice sociale au cœur du projet de développement durable, il faut changer de modèle et entreprendre une transformation des politiques sociales et environnementales. Pour Lucas Chancel, pour concilier les deux objectifs, l’Etat social doit être repensé pour articuler la prise en charge des risques environnementaux avec les outils traditionnels de la protection sociale. L’objectif est d’évoluer vers un Etat social-écologique, avec des mesures qui font baisser les inégalités tout en protégeant l’environnement.
Dans cette perspective, l’auteur émet un certain nombre de propositions, en s’appuyant sur diverses expériences menées dans différents pays. Citons-en quelques-unes à titre d’exemples :
Mesures socioécologiques
Réseaux énergétiques : en Suède, dans les années 1970, les pouvoirs publics ont développé des réseaux de chaleur urbains alimentés par des énergies renouvelables, gérés par des organismes publics liés aux communes. Cette mesure a permis de baisser la consommation des ménages et l’émission de gaz à effets de serre, tout en revitalisant le service public (lutte contre le déclin du patrimoine public) et en contenant le capital privé.
Coopératives énergétiques : en Allemagne, des particuliers ont investi dans des coopératives de production d’électricité ou de chaleur (structures cogérées). L’accès à ce type d’investissement est facilité (100 euros par citoyen). La plus grande coopérative compte 38 000 membres et distribue de l’électricité à 34 000 clients. Au total, l’investissement citoyen est de 20 milliards depuis 2000. La puissance publique a largement soutenu le projet, par des taux préférentiels et un cadre financier stable.
Mesures éducatives et de conseil
L’Etat doit développer des synergies entre les différents ministères et branches de l’administration (environnement, énergie, emploi, affaires sociales). En Suède, le calcul des aides sociales prend en compte les dépenses énergétiques, grâce à des conseillers sociaux qui évaluent ces dépenses énergétiques liées au logement, au transport. De même, en Allemagne, les aides destinées à l’énergie sont incluses dans le versement des aides sociales.
Financement de la réduction des inégalités environnementales
Une fiscalité écologique doit être mise en place à l’échelle mondiale. Outre la taxe carbone qui a été appliquée avec succès dans certains pays en l’associant à des mesures compensatoires pour les ménages les plus modestes, d’autres mesures peuvent être envisagées, par exemple une taxe sur les biens de consommation, notamment sur les billets d’avion, avec une taxation supérieure pour la première classe. Ainsi, un prélèvement de 20 euros sur un billet de 2ème classe, et 180 euros pour la 1ère classe permettrait de récolter 150 milliards d’euros. L’auteur propose également d’établir une taxe carbone aux frontières sur les produits importés en fonction de leur contenu carbone.
En se focalisant sur le PIB sans se soucier de la répartition des richesses ni de la pollution générée ou encore de l’appauvrissement de la sphère publique au profit d’intérêts privés, les sociétés modernes ont fait le choix de l’inégalité et entretiennent la crise environnementale. Pour autant, rien n’est figé, et il est encore possible de réagir, à condition de mener une réflexion profonde pour définir un véritable projet de société, pour une justice sociale et environnementale.
1 Lucas Chancel est économiste et enseigne à Sciences Po. Il est codirecteur du Laboratoire sur les Inégalités Mondiales à l’Ecole d’économie de Paris. Il codirige la World Inequality Database. Il est également chercheur associé à l’Institut du développement durable et des relations internationales. Il travaille sur les inégalités mondiales, l'économie politique de l'Union européenne et les enjeux de transition écologique.
Dans le dernier numéro de la célèbre revue de prospective Futuribles* notre ami Jean-François Soupizet, administrateur du Club des Vigilants, remet en perspective dans un grand article les tenants et les aboutissants des divers affrontements entre géants du Net et États. Aux États-Unis, en Europe et en Chine on est en effet passé au cours des années récentes d’une vision plutôt positive des bienfaits d’internet et de ses grands acteurs à une grande méfiance à l’égard de ces superpuissances et de leurs monopoles. Pour conclure cet état des lieux Jean-François s’est astreint à imaginer trois issues possibles au match. L’une est celle que l’on pourrait appeler le scénario médian : Les États se réveillent et démantèlent les géants du net. Les deux autres sont plus surprenantes. Dans l’un des scénarios GAFAM et BATXE acquièrent un statut de « quasi-États » sur lesquels croient pouvoir s’appuyer les ambitions des États-Unis et de la Chine, États qui finissent eux-mêmes par être « relégués à un rôle formel ». Dans l’autre, deux blocs antagonistes se constituent et l’internet lui-même se balkanise en une zone orientale et une zone occidentale avec une régulation forte des États dans chacune de ces deux zones.
*Numéro 444. Septembre-Octobre 2021
« Il fut un temps où le vivant était la seule réalité ! Mais en attendant que vienne l’âge de la sagesse : par quel extraordinaire pensons-nous avoir le droit d’anéantir des espèces millénaires, alors même que la nôtre se cherche encore ? »
Nous voilà repartis bille en tête pour une énième relance et l’espoir d’un retour à la croissance nourrissant inlassablement cette illusion alors qu’il s’agit plutôt d’envisager un nouveau modèle de développement dont est porteur cet ouvrage.
Les auteurs montrent qu’il faut changer de perspective, renoncer à vendre du « pas cher et quasi jetable » pour passer à l’économie de la fonctionnalité, c’est-à-dire la vente d’un usage. De ce point de vue, « ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis ! »
Pour Fabrice BONNIFET et Céline PUFF ARDICHVILI, il est avéré que la recherche du sens face à l’impasse prévisible nous impose une autre vision.
Cela suffit de notre engoncement dans l’anthropocène et la thermo-industrie à la conquête de l’inutile. Faire autrement, telle est la condition préalable. C’est affaire de méthode et pas de but sans méthode !
Il faut réintégrer l’entreprise dans la nature, redéfinir sa raison d’être, qu’elle soit incarnée avec des objectifs mesurables ambitieux. Ce n’est pas qu’un enjeu d’image. Tout en dépend !
Un décès sur cinq dans le monde est déjà dû à la pollution. Nous n’avons pas le temps d’attendre la solution technologique miracle, car générer de l’abondance frugale en énergies et en ressources n’est pas une option mais une obligation mathématique et financière. L’argent est certes la respiration de l’entreprise, mais il ne peut pas en être la vision ni la raison d’être crédible. De plus, le futur n’est pas écrit et relève de l’audace des initiatives de l’ici et du maintenant.
C’est en cela que toujours vouloir sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on en finit par oublier l’extrême urgence de l’essentiel !
Fabrice BONNIFET est une référence du développement durable en France, le directeur du développement durable de Bouygues agit avec passion au sein de son entreprise et auprès des communautés qui rassemblent ceux qui veulent vraiment agir. En tant que président du collège des directeurs de développement durable (C3D), il entraîne les entrepreneurs et les professionnels de la RSE vers la réinvention de leur entreprise.
Céline PUFF ARDICHVILI est communicante et entrepreneure. Influenceuse un poil indignée, elle a repris ses études pour intégrer dans son métier les enjeux du développement durable dont elle souhaitait comprendre les mécanismes, pour agir. Partenaire dirigeante au sein de l’agence Look Sharpe, elle s’emploie à donner de la visibilité aux acteurs du changement.
« … Le capitalisme ? C’est comme le Temps. Si personne ne me le demande, je le sais. Si je veux l’expliquer à qui me le demande, je ne le sais plus. Mais on peut se risquer à l’associer au mot combat ! »
L’auteur de cet opus éclectique et serré replace l’économie dans sa nature de science sociale, et en convoque les acteurs majeurs et l’élitisme paradoxal qui l’anime aujourd’hui.
Il fouille véritablement en historien et mémorialiste le capitalisme dans sa si longue épopée.
Sa manière d’entrer dans le sujet avec ardeur et hauteur va au cœur de la question et des enjeux, pour la clore sur le dilemme qui donne à entrevoir la distance à franchir, non sans quelques crochets.
De fait, le capitalisme, sous sa forme libéralisée et financière, conduit à une instabilité croissante et des crises économiques à répétition, fort détachées de l’impératif de justice sociale et d’épuisement des ressources.
La réalité du capitalisme mondialisé est restée une machine à produire des inégalités mondiales.
Il est moins l’économie de marché que sa dénaturation, et sa plasticité se décline de manière stupéfiante, jusqu’à repenser un compromis social plus équitable pour s’opposer aux nouveaux gagnants de la mondialisation.
Etonnamment, l’arbitrage coûts-bénéfices à l’œuvre ne répond-il pas avec le choix du confinement et la mise à l’arrêt de la production, à un renversement des hiérarchies sociales par une vision lucide sur la valeur d’une vie humaine, évaluée en France autour de trois millions d’euros en termes de richesse potentielle ?
Arnaud Pautet, citant Milanovic, met en exergue l’existence d’un incroyable avantage qui se traduit par le fait que 60% du montant du revenu perçu par un individu dépend du pays dans lequel il vit ; 20% de son origine sociale et que seulement 20% tient au mérite.
Dans cet univers capitaliste éclaté, et qui nous demande de ne pas laisser nos cerveaux au vestiaire, la fin des choses n’est pas encore venue !
Arnaud Pautet est agrégé et docteur en histoire contemporaine. Il est professeur en classes préparatoires commerciales au lycée Sainte-Marie de Lyon où il enseigne l’histoire, l’économie et la géopolitique.
Avec la collaboration de Francis Plancoulaine, professeur agrégé en sciences sociales enseignant l’économie, la sociologie et l’histoire en classes préparatoires commerciales.
« …Attention au déséquilibre engendré entre le réel et le Toc, si létal pour l’économie»
Les auteurs de cet ouvrage dense nous enjoignent d’appliquer une vraie coupure et une méthode face aux bouleversements et incessantes remises en question de cette oppressante pandémie coronavirus qui n’a pas infecté que la sphère de la santé.
Ils en appellent au compromis sur la base d’une exigence de justice sociale, de la classe ouvrière aux couches dirigeantes, comme une condition de la cohésion française.Ils la nomment « entreprise cohésive », et lui vouent une ambition de transformation radicale de la société toute entière, déclinant le cahier de doléances en deux impératifs politiques et quatre exigences sérieusement argumentées.
A cet égard, l’horizon souhaitable n’est assurément pas la fin du salariat fantasmé par certains, mais plutôt une implication plus grande des salariés, singulièrement des nouvelles générations, dans leur entreprise à travers l’actionnariat et la gouvernance associée.
En fait, il s’agit avec pragmatisme de partager la richesse là où elle est créée plutôt que la redistribution a postériori, en élargissant la propriété privée ! Voilà l’idée neuve.
L’enjeu vise à éviter à plus large échelle le basculement de centaines de millions de personnes dans une pauvreté radicale
Pour Christian Pierret et Philippe Latorre, la voie qui s’offre à notre pays est politique.
La logique de confrontation doit laisser place à une politique de co-construction sur le mode social-démocrate, car ce qui est en cause c’est l’adaptation des entreprises à une économie post-covid et plus favorable au progrès de la parité.
Etant englué jusqu’à l’étouffement dans des conjonctures excentriques, cet ouvrage est stimulant, énergique et retient l’attention !
Il propose une issue lucide et plus heureuse à l’impasse.
Christian PIERRET est avocat et administrateur de jeunes entreprises innovantes. Il a été haut fonctionnaire, député, rapporteur général du budget à l’assemblée nationale, maire, et ministre en charge de l’industrie de 1997à 2002.
Philippe LATORRE, cofondateur d’un fonds dédié aux PME françaises, a une longue expérience des fonds d’investissement. Il apporte son expertise à un cabinet d’avocats et exerce une activité de conseil auprès des salariés.
Tel est le titre d'un essai d'Ismaël Saidi, réalisateur et auteur de la pièce « Djihad » unanimement saluée par la presse et le monde de l'éducation.
Loin de la litanie des récriminations qu'on pourrait attendre de la part de ce musulman maghrébin (discriminations, racisme, etc.), ce livre raconte son odyssée en France, dont il parcourt les villes et les villages pour présenter sa pièce, les rencontres qu'elle lui procure avec son public, les questions qui taraudent les spectateurs et l'appel à la raison qu'il leur propose dans ses réponses.
Ce livre est une véritable lettre d'amour à notre pays.
Comment sauver le libéralisme ? À cette ambitieuse question, Bernard Esambert, ancien président du Club des vigilants, dont nous avions évoqué dernièrement le ciné-portrait, propose une réponse non moins ambitieuse : il faut introduire ou réintroduire de l’éthique dans le comportement des agents économiques et notamment des riches et des puissants.
La quatrième de couverture du livre que vient de publier la Fondation éthique et économie sous sa direction commence ainsi : « L’économie d’aujourd’hui n’est-elle pas un défi aux valeurs de justice et de respect de la dignité humaine ? L’économie libérale est celle de la liberté des acteurs, mais leurs droits ne peuvent être défendus sans insister sur les devoirs qui y correspondent. »
Bernard pense qu’il faudrait formaliser ces devoirs dans une charte synthétisant la pensée des théoriciens et praticiens de l’économie mais aussi des « spécialistes » de l’éthique et de la morale, les autorités religieuses de toutes les grandes religions.
Pour en débattre il avait organisé avec l’appui de quelques autres et notamment de Bertrand Collomb une série de passionnantes conférences à l’Institut, conférences dont le Club des vigilants, partenaire de ce beau projet, avait rendu compte régulièrement sur ce site.
Les actes 2012-2019 tout juste publiés permettent de retrouver le texte de toutes ces conférences et la diversité des intervenants de très haut niveau mêlant universitaires (Blanche Segrestin, Jean Tirole, Gaël Giraud, Suzan Berger, Jean-Pierre Dupuy, Zuo Xuexin de Shanghai), anciens patrons (Bernard Esambert et Bertrand Collomb bien sûr mais aussi Narayana Murthy, président fondateur de la société indienne Infosys dont l’intervention avait été particulièrement passionnante), responsables ou anciens responsables d’organisations internationales (Michel Camdessus, Pascal Lamy, Angel Gurria) et représentants de toutes les grandes religions, notamment le cardinal Philippe Barbarin, le père Baudoin Roger du Collège des Bernardins, le grand rabbin Haïm Korsia…
À ces textes de conférences s’ajoutent les rapports de plusieurs groupes de travail sur les inégalités, la finance, l’environnement… et l’esquisse d’une charte par Bernard Esambert.
Des travaux qui méritent d’être lus, relayés, amplifiés et popularisés pour déboucher sur des actions concrètes.
Éthique et Économie : comment sauver le libéralisme ? Actes de la Fondation 2012-2019, sous la direction de Bernard Esambert. Ed° les ozalids d’humensis. Peut être commandé en ligne sur toutes les plateformes, ou, encore mieux, chez son libraire préféré.
Face à une opinion dominante en France selon laquelle l’islamisation produit du terrorisme, fortement portée par le très médiatique Gilles Kepel[i] et sa « radicalisation de l’Islam », Olivier Roy, philosophe persanophone et politologue spécialiste de l’Islam, aujourd’hui professeur à l’Institut universitaire européen de Florence (où il dirige le Programme méditerranéen), défend l’idée d’une « islamisation de la radicalité »[ii] [iii].
Il fonde son analyse sur l’évolution du profil des auteurs d’attentats terroristes. Pour résumer, depuis 25 ans il y a une continuité dans ces attentats, qui sont toujours des attentats suicides (cf. son livre « Le Djihad et la mort », Seuil, 2019) mais il existe en revanche une rupture dans le mode opératoire. Aujourd’hui on a affaire à des terroristes isolés, sans « réseaux » derrière eux (absence de liens avec Daech notamment), qui agissent donc seuls, en utilisant une arme blanche, qui rend leur attentat « sacrificiel ». Par ailleurs, ils s’inscrivent, via la médiatisation espérée de leur acte, dans ce qu’Olivier Roy qualifie d’une « certaine culture jeune » alimentée par les réseaux sociaux, où il y a « cette idée que tout est dans la communication, que l’on passe de l’anonymat à la célébrité ». L’islamisation joue bien sûr un rôle, puisque l’auteur, par son geste « gagne le paradis ».
[i] Philippe Bois avait fait en février 2016 la recension du livre de Gilles Kepel co-écrit avec Antoine Jardin « Terreur dans l’hexagone, genèse du Djihad français »
[ii] Pour éclairer le débat entre Gilles Kepel et Olivier Roy, cet article des Echos : "Le prophète et le mandarin"
[iii] Auteur de La Sainte Ignorance, dont les analyses ont fait la une du New York Times après les attentats du Bataclan, Olivier Roy est un homme engagé qui aime se confronter au « terrain » (il est parti participer aux combats de la guerre d'Afghanistan contre l'URSS dans les années 80).
Belle interview d’un artiste humaniste qui fait preuve d’une capacité rare de compréhension des « émotions populaires » que beaucoup de nos politiques pourraient (devraient) lui envier. Esprit critique et anxieux face aux évolutions du monde actuel, grand lecteur et cinéphage (l’interview fourmille de références), Dupontel est amené à parler aussi bien du « chaos géopolitique » que de « la parole médiatique » (« aux mains de peu de monde, et ça se voit »).
#MeToo, les Gilets jaunes, Black lives matter ? Des « paroles d’opprimés face à des oppresseurs », différentes expressions pour lui de « l’impuissance de la parole citoyenne », dont il ne comprend pas qu’on ne la facilite pas plus, quand notre parole de consommateur est sans arrêt sollicitée.
De manière récurrente dans cet entretien (d)étonnant, il défend l’idée de la Culture comme fondement pour un avenir durable, et notamment de la culture (partagée) comme socle de notre identité européenne. Pour lui, comme une sorte de leitmotiv, l’importance d’une « éducation qui amène à la culture », pour éviter des « égos humains mal formés ». Ce qui passe par une autre façon d’enseigner, moins compétitrice. Il croit en la capacité des générations futures à panser beaucoup de nos maux actuels. Pas trop en celle des « vieux » (il a 56 ans) comme lui…
Son conseil aux plus jeunes : « N’écoutez pas trop les adultes » !
Avant même la fin de la crise commence le temps des bilans.
Après avoir rappelé l'historique de la pandémie, celui dressé par Charles-Elie Guzman dans UP Magazine souligne à quel point certains modèles mathématiques sur lesquels se sont appuyés des scientifques pour publier leurs prévisions apocalyptiques étaient faibles, voire faux. Ainsi, le modèle vedette de l'Imperial College, sur la foi duquel l'OMS et certains dirigeants politiques ont préconisé et mis en place un confinement généralisé, a pu être qualifié "d'erreur informatique la plus dévastatrice de tous les temps". Les critiques et les voix proposant des alternatives ont été rendues inaudibles par la pression médiatique.
De même, les études prouvant l'efficacité du confinement en France auraient été largement biaisées.
PS : l'accès à l'article de UP Magazine étant soumis à une inscription préalable, le Club vous en propose une copie, tout en vous conseillant cette inscription
André Comte-Sponville est un philosophe rationaliste, disciple de Spinoza, auteur prolifique notamment sur l'éthique et la morale. Lors d'une interview sur France Inter, il s'est récemment étonné de l'affolement collectif qui a saisi nos concitoyens à propos de la pandémie actuelle, rappelant que « la mort fait partie de la vie », appelant à « ne pas faire de la santé la valeur suprême de nos existences ».
Selon lui on assiste à un renversement complet des valeurs de nos civilisations « où l'on considérait, à l'inverse, que la santé n'était qu'un moyen, alors certes particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est le bonheur ».
Une réflexion salutaire qui nous rappelle que la priorité des priorités de nos sociétés devrait être « les enfants et les jeunes en général » et non les personnes âgées que le confinement a le plus protégées alors qu'elles ne sont pas menacées par l'arrêt de l'activité économique.
Le revenu universel, qui avait disparu du débat public depuis la dernière campagne présidentielle (l'idée avait été portée par Benoît Hamon), revient en force à l'occasion de la pandémie COVID-19 et de la crise sociale qui s'annonce. Autrement appelée "argent hélicoptère", l'idée séduit nombre d'économistes (l'ex-président de la BCE, Mario Draghi, l'avait jugée "intéressante").
L'article analyse la faisabilité d'une telle mesure.
Le Club avait organisé une Matinale sur ce thème que vous pouvez retrouver ici.
Sa vie professionnelle a donné l’occasion à Jérôme Cazes de voir de près les dangers auxquels nous expose la finance de marché quand elle est pratiquée par les mêmes banques qui gèrent nos comptes et nous accordent nos crédits. Dans cette vidéo d’une conférence TED X l’ancien président du Club des Vigilants expose en une quinzaine de minutes l’essentiel de ses idées sur le sujet.
Green Cross France et Territoires, présidée par Jean-Michel Cousteau, est la branche française de l'ONG Green Cross, fondée par Mikhaïl Gorbatchev en 1993. "Afin de préserver la paix et un avenir durable pour chacun, GCFT œuvre pour conserver un milieu sain, garant d’un avenir serein". Leurs activités de plaidoyer et les projets concrets qu'ils ont menés les ont conduits à publier d'excellents ouvrages de vulgarisation, destinés à la fois à alerter et à donner des pistes de solutions autour des grands enjeux liés au dérèglement climatique. Ces ouvrages, intitulés "des clefs pour agir", sont téléchargeables gratuitement sur un site dédié.
Alain de Vulpian, l'un des administrateurs fondateurs du Club, a reçu pour son dernier livre "Eloge de la métamorphose - En marche vers une nouvelle humanité" le prix de l'essai 2016 de l'Académie française. Nous évoquions son livre dans le dernier "Vigilances".
Dans la dernière partie, "En route vers l'avenir", le chapitre intitulé "Notre démocratie tarde à entrer dans le jeu de la société des gens" nous aide à mieux comprendre le succès rencontré depuis quelques temps par des initiatives de la société civile révélatrices de la prise de conscience de cette situation : c'est l'émergence de ce qu'on appelle les "civic tech" dont nous vous avions signalé quelques exemples typiques.